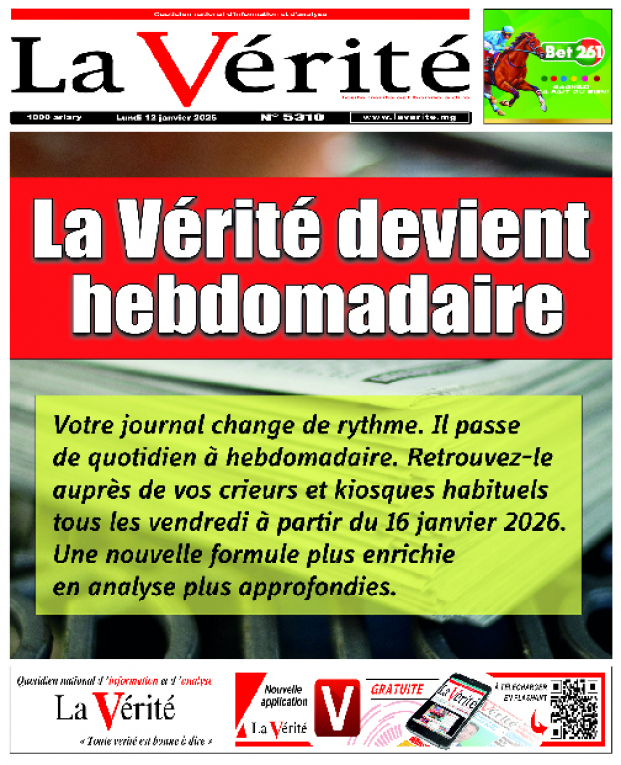« Les problèmes climatiques favorisent les migrations de longue distance. Des victimes du Kere dans le Sud de l’île ces 100 dernières années migrent dans les Régions de Menabe ou d’Atsimo- Andrefana. Pour accéder à la terre, ces migrants optent pour le défrichement ou la déforestation », illustre le Pr Ramisandrazana, enseignante chercheur. « Mais le pire c’est qu’en ce moment, certains d’entre eux sont exploités par des étrangers pour la culture de maïs et d’arachide, en vue d’une importation ou de transformation agroalimentaire », alarme ce directeur de recherche associée auprès du Centre national de recherches sur l’environnement (CNRE). D’un autre côté, la non-maîtrise des migrations dans l’Androy et le Menabe augmente les tensions et les conflits sociaux, constituant une menace à la paix et la cohésion sociale.
Un Observatoire pour renforcer les enquêtes
En manque de statistiques. Madagascar ne dispose pas des données adéquates concernant les migrations internes. Une des raisons pour la mise en place d’un Observatoire des migrations internes, fruit du partenariat entre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le PNUD et le CNRE. Sa création permettra de renforcer les enquêtes pour évaluer la situation actuelle et déterminer les issues. En fait, l’Observatoire ambitionne d’être une première structure dans le pays qui servira de plateforme de référence pour étudier, produire et affiner à travers le temps les connaissances sur un certain nombre de paramètres et enjeux sociaux, politiques, économiques et environnementaux rencontrés à Madagascar en lien avec les phénomènes de migrations internes. L’Observatoire sera également une plateforme d’échange, pour la diffusion et discussion des connaissances sur ces phénomènes et leurs dynamiques au sein de la communauté scientifique nationale et internationale et au-delà, notamment auprès des décideurs et des autres parties prenantes, comme le grand public et la société civile, dans la planification de leur réponse et dans l’élaboration de stratégies qui visent à une meilleure gestion des migrations internes. « Les capacités de l’équipe de l’Observatoire seront utilisées pleinement pour que les décideurs politiques puissent avoir une meilleur compréhension, une bonne évaluation du phénomène actuel des migrations internes afin de prévoir les impacts et formuler une stratégie de gestion éclairée et avisée des migrations internes à Madagascar », confirme Yves Mong, directeur du CNRE. Les données produites par l’Observatoire vont contribuer à la formulation d’une politique durable de la migration à Madagascar.
Recueillis par Patricia Ramavonirina