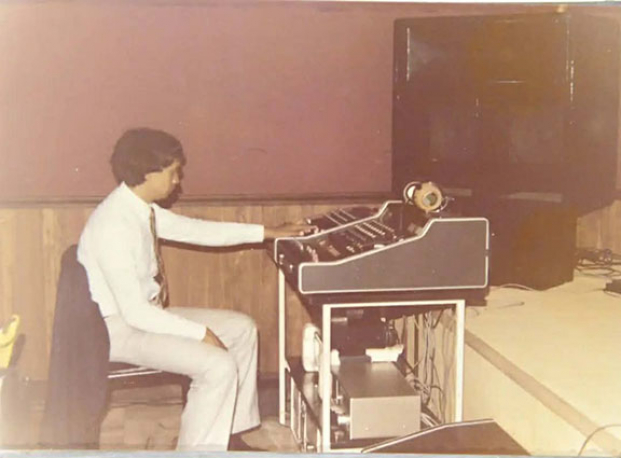Miracle rwandais. Enclavé au même titre que le Burundi, le Rwanda se trouve « coincé » entre les géants du Congo (RDC) à l’ouest et des Ouganda/Tanzanie à l’est. Rwanda et Burundi, les deux petits « poucets » de l’Afrique de l’Est, ne pèsent pas lourd géographiquement vis-à-vis de leurs voisins. Toutefois, ils ont chacun leurs parcours. Si le premier brille jusqu’à être couronné de succès méritant le qualificatif de « miracle rwandais », le second patauge sous le joug d’un dictateur.
Meurtri par une terrible guerre civile en 1994 (de 7 avril à 17 juillet) ayant coûté la vie à 800.000 personnes dont principalement des Tutsi, le Rwanda mit deux décennies pour se redresser. La grande tuerie, généralement appelée le « génocide rwandais », fut l’évènement tragique d’une ampleur jamais atteinte qui marqua l’Histoire moderne de l’Afrique.
En vingt ans de bataille acharnée contre les maux causés par la guerre civile et sous la direction éclairée d’un dirigeant hors-pair Paul Kagamé, les Rwandais sont parvenus à remettre sur la voie de la réussite leur Nation. On n’hésite pas de qualifier les efforts de « miracle économique et social rwandais ». Dès 2012, le taux de croissance économique du pays a atteint le chiffre record de 7%. Au moins, trois causes essentielles expliquent le miracle.
D’abord, l’esprit de la discipline. Les Rwandais suivirent à la lettre les consignes mises en place par leurs dirigeants. Francophone au même titre que le Burundi, Rwanda réussit, en l’espace de vingt ans, à se balancer de la francophonie à l’anglophonie, et ce, grâce aux efforts soutenus de tout le monde d’apprendre et de maîtriser la langue de Shakespeare. L’autre facette du miracle rwandais. Le respect de la loi fait partie d’un point positif non négligeable auquel tous les citoyens en sont fiers.
Ensuite, la mobilisation nationale, autour d’une valeur ancestrale « Umuganda », sous la forme d’une journée de travail communautaire contribue à grands pas au bond économique et social du pays. Un phénomène social unique où tous les Rwandais s’investissent « à cœur joie » et s’identifient en tant que citoyens responsables.
Le troisième point et non des moindres qui traduisent en termes réels la réussite rwandaise réside dans la lutte sans pitié contre la corruption. La « tolérance zéro » initiée par Paul Kagamé et dictée par la nécessité d’assainir le système a porté ses fruits. Le Rwanda se trouve en tête de peloton des pays les mieux classés en Afrique dans le combat contre la corruption.
Devrait-on s’étonner si le Rwanda, à la lumière de ces trois points positifs, arrive à se positionner, en Afrique, parmi les pays les mieux cotés et fièrement pris en exemple de réussite ?
Madagasikara, la Grande île, a beaucoup à apprendre de ce « petit poucet » de l’Afrique de l’Est mais « un géant » du continent noir. Il ne suffit pas de s’émerveiller des prouesses économiques des rwandais, il faut s’atteler avec tous les efforts utiles et continus pour redresser notre pays. En cinquante ans d’indépendance, Madagasikara n’a fait que reculer sinon de … descendre et cela pour rejoindre le fond de la cave.
L’exemple rwandais nous met en évidence que tout est du domaine du possible ou réalisable du moment qu’on se donne la volonté d’agir
Ndrianaivo