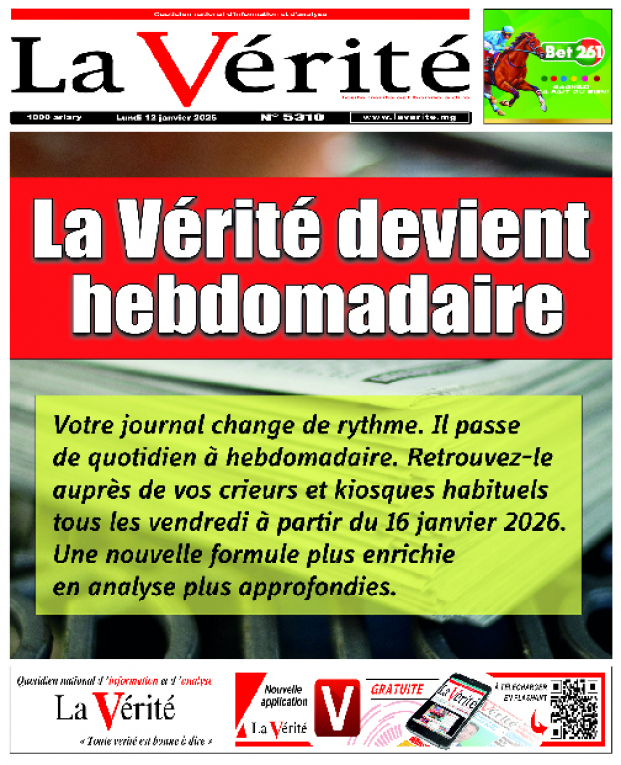Le premier Projet de loi de Finances initiale (PLFI) pour 2026, censé incarner l’acte fondateur de la « refondation » promise par le nouveau pouvoir de transition, prend à contre-pied cette ambition. Loin de marquer une rupture, il reconduit massivement les lignes budgétaires héritées du précédent régime et accorde des enveloppes conséquentes aux appareils de l’Exécutif. Adopté à la hâte en Conseil des ministres, deux jours à peine après la nomination du Gouvernement, le texte apparaît davantage comme un budget de continuité que comme la matrice d’une nouvelle politique publique.
Le ministre de l’Economie et des Finances, Herinjatovo Aimé Ramiarison, ne s’en cache pas : le document a été préparé dès le mois de mars, donc sous l’ancien Gouvernement. Derrière les mots de la « refondation », les chiffres, eux, témoignent d’une constance frappante. Une refondation différée, en somme.
Le discours gouvernemental évoque un recentrage des programmes d’investissement public sur l’énergie, l’eau, la santé et l’éducation. Pourtant, la présentation même du budget illustre le contraire : la refondation est renvoyée à plus tard, dans l’attente d’une hypothétique loi rectificative. Le ministre tente de rassurer l’opinion publique en annonçant une loi de Finances rectificative pour juillet 2026, destinée à « ajuster si besoin ». En reconnaissant que le PLF 2026 n’est qu’un texte de transition, le pouvoir admet implicitement que la rupture tant souhaitée n’est pas encore amorcée.
Certes, cette prudence peut se comprendre dans un contexte institutionnel encore instable, mais elle renforce le sentiment d’une continuité déguisée. Aux yeux d’une opinion publique lassée des discours, l’annonce d’une refondation sans réforme tangible alimente la défiance.
Avant même son adoption parlementaire, le projet de loi de Finances 2026 révèle une continuité assumée. Les mêmes députés qui validaient hier les budgets du précédent régime s’apprêtent à faire de même, sous couvert de renouveau.
Une continuité budgétaire flagrante
Les montants inscrits pour les institutions de prestige confirment le poids persistant de l’Exécutif dans la dépense publique. La Présidence de la République bénéficie d’une enveloppe de 313,9 milliards d’ariary, la Primature d’un budget record de 633,4 milliards, tandis que l’Assemblée nationale dispose de 76,8 milliards. Ces chiffres, extraits du tableau de répartition par institutions et ministères du PLF 2026, confirment la solidité financière des pôles de pouvoir exécutif et la concentration des moyens entre leurs mains, au moment même où le discours politique prétend amorcer une ère nouvelle de sobriété et de refondation.
Ainsi, le contraste entre la parole politique et la structure du budget saute aux yeux. D’un côté, le Gouvernement proclame la volonté d’un Etat exemplaire et sobre ; de l’autre, il entérine des dotations généreuses pour la Présidence et la Primature, et maintient un train de vie institutionnel peu compatible avec la situation économique du pays. Sans réforme plus profonde du système de rémunération et des dépenses de fonctionnement, elle ne changera guère la structure d’un budget où l’essentiel des ressources reste capté par le sommet de l’Etat.
Dans le même temps, le plafond global des crédits pour l’ensemble des pouvoirs publics et ministères atteint 15 777 208 696 ariary, soit un niveau qui traduit davantage une consolidation du statu quo qu’une politique d’austérité. La création d’une « Mission 101 – Refondation » directement rattachée à la Présidence renforce encore le rôle central de l’Exécutif dans la mise en œuvre du projet gouvernemental.
Les ministères sociaux : importants mais insuffisants face aux enjeux
Le Gouvernement assure que la santé et l’éducation figurent parmi les priorités du nouveau budget. Le ministère de l’Education nationale dispose effectivement d’une enveloppe de plus de 2 315 milliards d’ariary, tandis que la Santé publique reçoit environ 856 milliards. Ces montants, élevés en valeur absolue, doivent toutefois être relativisés. Leur évolution réelle par rapport aux besoins nationaux reste insuffisante au regard de la dégradation des infrastructures scolaires et sanitaires. Une lecture détaillée du document budgétaire révèle par ailleurs que la majorité des augmentations concerne les dépenses de fonctionnement : salaires, primes et charges administratives absorbent encore la plus grande part des crédits, au détriment de l’investissement direct dans les services à la population.
Les contradictions les plus saillantes
La concentration des moyens sur l’Exécutif traduit clairement la persistance d’un Etat qui se finance avant tout pour assurer la continuité de ses appareils de pouvoir. A cela s’ajoute un scepticisme croissant face à certaines mesures jugées purement symboliques, comme la taxe de 25 % sur les hauts salaires. Cette mesure, sans réforme structurelle des indemnités, primes et enveloppes de fonctionnement, ne saurait à elle seule corriger les déséquilibres internes du budget. L’exposé des motifs évoque bien des réformes salariales et la revalorisation de certaines caisses, mais la traduction concrète de ces intentions reste encore à démontrer, programme par programme.
Entre rhétorique et réalité chiffrée
Le PLF 2026 contient incontestablement des éléments de langage liés à la refondation et met en avant des priorités sociales sur le papier. Pourtant, à la lecture des montants et de la structure budgétaire inscrite dans les annexes, il témoigne avant tout d’une continuité : les enveloppes de la Présidence et de la Primature demeurent importantes, les lignes de fonctionnement substantielles, et le calendrier d’ajustement repoussé à plus tard. En définitive, la refondation se limite pour l’instant à une rhétorique, tandis que la réalité budgétaire traduit surtout la permanence d’un système qui se renouvelle dans les mots, mais se prolonge dans les chiffres.
R.L.