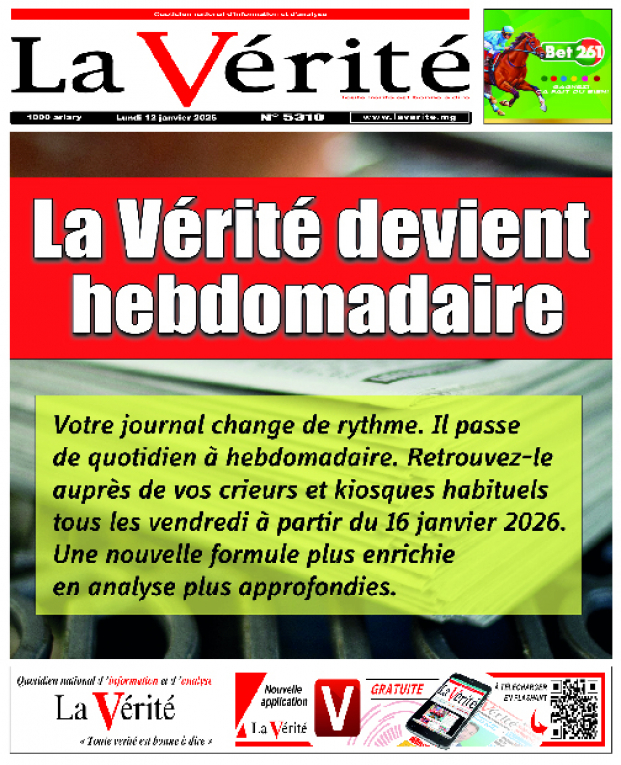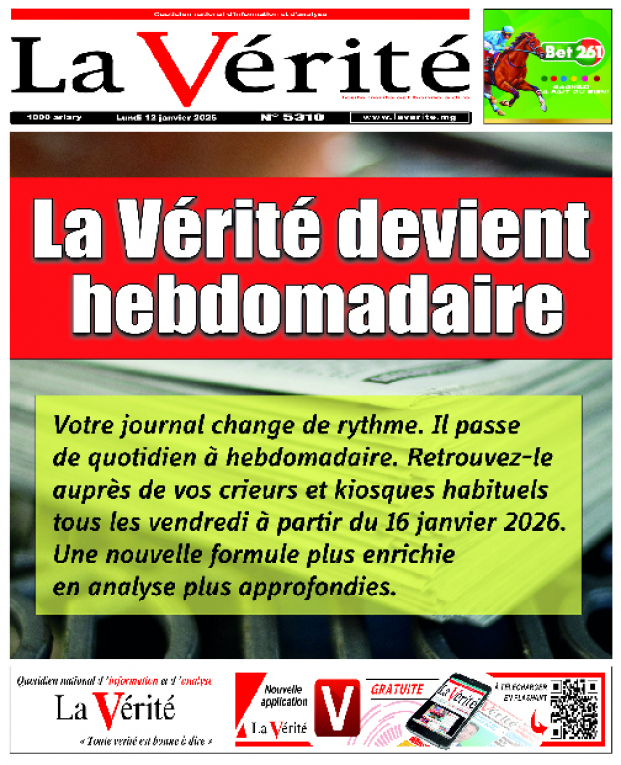Harcèlement scolaire - Haingo Rakotomanga a souffert en silence
Publié le jeudi, 22 janvier 2026Elle avait 12 ans. Elle était en classe de 5ème à l’école des sœurs sise à Andohalo. Elle avait une meilleure amie, une présence rassurante à ses côtés pendant des mois avant que tout change. Elle, c’est Haingo Rakotomanga, une survivante de harcèlements scolaires mais qui a pu s’en rétablir pour devenir une femme entrepreneure.
« Ma meilleure amie et moi ne se quittions jamais, mais elle s’est éloignée, m’a ignorée et s’est même moquée de moi, des changements brusques que je n’arrivais pas à accepter. Je lui ai finalement demandé la raison et sa réponse a été un coup dur "parce que tu es trop sage !" », se souvient-elle. Depuis, elle a subi de nombreux cas de harcèlement scolaire, dont les surnoms, les rires moqueurs, les regards insistants. Son ancienne meilleure amie a même fait partie des premières à se moquer d’elle, surtout à cause de sa physique qu’elle avait elle-même du mal à reconnaître. « J’avais l’impression qu’on se moquait de moi tout le temps. Je me suis renfermée et a gardé le silence, non seulement à cause de la honte mais surtout par peur qu’en parler va empirer la situation », raconte-t-elle.
La Vérité devient hebdomadaire
Publié le lundi, 12 janvier 2026LA VERITE
Publié le lundi, 12 janvier 2026
La UNE du 080126
Publié le jeudi, 08 janvier 2026
Taom-baovao 2026 - L’IFM ouvre la saison sous le signe de la « Mémoire et de la Création »
Publié le jeudi, 08 janvier 2026L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la mémoire et de l’avenir à Madagascar, avec un rendez-vous incontournable : la soirée Taombaovao organisée par l’Institut Français de Madagascar (IFM). Ce moment de célébration, qui se tiendra le samedi 24 janvier à partir de 18h30 dans le quartier animé d’Analakely, ne se limite pas à une simple fête de début d’année. Il incarne une véritable passerelle entre héritage culturel et création contemporaine, un espace d’échanges où artistes, partenaires, étudiants et passionnés se retrouvent pour partager une vision commune du futur. Depuis plusieurs années, Taombaovao s’est imposé comme un rendez-vous majeur du calendrier culturel malgache, attirant aussi bien les talents locaux que des artistes internationaux.
Entre Novembre et Décembre 2025 - 25 véhicules du groupe Sodiat saisis lors d’opérations controversées
Publié le jeudi, 08 janvier 2026Le groupe Sodiat et sa filiale Auto Diffusion dénoncent des opérations qu’ils jugent irrégulières après la saisie de vingt-cinq (25) véhicules leur appartenant, intervenue lors de plusieurs actions menées entre novembre et décembre 2025. Dans un communiqué publié hier, Auto Diffusion revient notamment sur le cas de quatorze (14) véhicules neufs sortis du port de Toamasina dans des conditions qualifiées d’illégales.
Selon la société, ces 14 véhicules, importés régulièrement dans le cadre de ses activités commerciales, ont été retirés du parc automobile de la SMMC au port de Toamasina le 31 décembre 2025, entre 19 heures et 20 heures. Cette opération serait intervenue en violation des procédures de dédouanement en vigueur. Auto Diffusion affirme que les véhicules ont été enlevés manu militari, au détriment du mandataire officiellement désigné pour assurer leur dédouanement, alors même que les documents nécessaires étaient encore en attente de validation.
Choc mortel sur la RN4 Ankazobe - Une personne succombe sur le coup, des enfants blessés
Publié le jeudi, 08 janvier 2026Un accident mortel a eu lieu aux abords d'Ankazobe, sur la RN4, impliquant un taxi-brousse Mercedes Benz Sprinter en provenance de Mahajanga. Le véhicule a violemment percuté un talus après une perte de contrôle, entraînant la mort d'une passagère sur le coup. Selon les témoignages recueillis, la victime, qui se trouvait sur la banquette du bas-fond, a été surprise par la violence du choc et n'a pas eu le temps de réagir, ne présentant aucune blessure visible à l'extérieur.
Refondation - Le chef de l’État reconnaît une guerre intestine
Publié le jeudi, 08 janvier 2026Le chef de l’État a reconnu publiquement l’existence de profondes tensions internes au sein de la République de la Refondation qu’il dirige. Une situation qui, à l’entendre, pèse lourdement sur l’avancement de plusieurs chantiers majeurs, dont la concertation nationale, qui pour beaucoup aujourd’hui apparaît au point mort.
S’exprimant à Antsiranana, le colonel Randrianirina Michael a en effet pointé du doigt des calculs politiques internes déjà bien engagés, qu’il considère comme l’une des principales causes du blocage actuel. Les stratégies et les ambitions personnelles ont pris le pas sur l’intérêt collectif, a-t-il laissé entendre, tout en affirmant que le pouvoir exécutif continue néanmoins de fonctionner et refuse de céder à l’immobilisme.
Grève surprise à l’Hôtel Carlton - Les salariés dénoncent une « mise au chômage technique » sans préavis
Publié le jeudi, 08 janvier 2026Hier matin, les employés de l’Hôtel Carlton ont arrêté le travail pour protester contre une décision jugée « brutale et arbitraire » de la Direction générale. Lors d’une réunion organisée le 6 janvier, Sam Van Campenhout, le directeur général, aurait annoncé la mise en chômage technique immédiate de l’ensemble du personnel, sans concertation ni clause de sauvegarde. Selon les représentants du personnel, l’annonce est intervenue sans aucun préalable, et les salariés ont appris, au même moment que leurs collègues, qu’ils ne seraient plus rémunérés.
Électricité - Un apport de 43,5 MWc de solaire pour dynamiser le RIA
Publié le jeudi, 08 janvier 2026Le secteur énergétique malgache s’apprête à franchir une étape déterminante pour sa stabilité financière avec l’intégration imminente de nouvelles capacités renouvelables au sein du Réseau interconnecté d’Antananarivo. D'ici la fin de ce mois de janvier, une injection massive de 43,5 MWc d'énergie solaire est attendue, provenant des parcs photovoltaïques récemment implantés à Ambatomirahavavy, Ilafy, Mangatany et Ampangabe. Le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Ny Ando Jurice Ralitera, a précisé lors d’une émission spéciale que cette opérationnalisation constitue un levier économique majeur pour réduire la dépendance aux centrales thermiques, dont le coût en carburant grève lourdement le budget de l’État.
Fil infos
- La Vérité devient hebdomadaire
- Refondation - Le chef de l’État reconnaît une guerre intestine
- Grève surprise à l’Hôtel Carlton - Les salariés dénoncent une « mise au chômage technique » sans préavis
- Université d’Antananarivo - Le Dr Alain Mérieux honoré du titre de Docteur Honoris Causa
- Mpox - Madagascar sous surveillance sanitaire de ses îles voisines
- Polyclinique Ilafy - Des mesures temporaires évoquées par le gouvernement pour les patients dialysés
- Prime à la HCC - Le ministère de l’Économie et des Finances clarifie
- Haute Cour constitutionnelle - Les primes de la honte
- Message du nouvel an - « C’est en mon âme et conscience que j’ai fait le choix de m’écarter » dixit Rajoelina
- Pillage au port de Toamasina - 14 véhicules du Groupe Sodiat emportés
Editorial
-
Opération délicate
Le faux et l’usage de faux envahissent l’Administration, grand « A » s’il vous plaît, à savoir le domaine général qui englobe tous les secteurs d’activités de l’Etat ou de la République. Faux et usages de faux, du jargon populaire « fosika », faux diplômes ou certificats de fin d’étude gangrènent presque tous les Corps de métier de l’Administration entre autres les départements clés comme l’Enseignement supérieur, l’Education nationale, la Justice, la Régie financière, les Forces de défense et de la sécurité (FDS), etc. Les concours d’entrée dans l’administration publique sont infestés de faux dossiers. Des diplômes de Baccalauréat, de Licence, de Master I ou II se trouvent les plus menacés. Il y a eu même certains de faux diplômes de Doctorat !