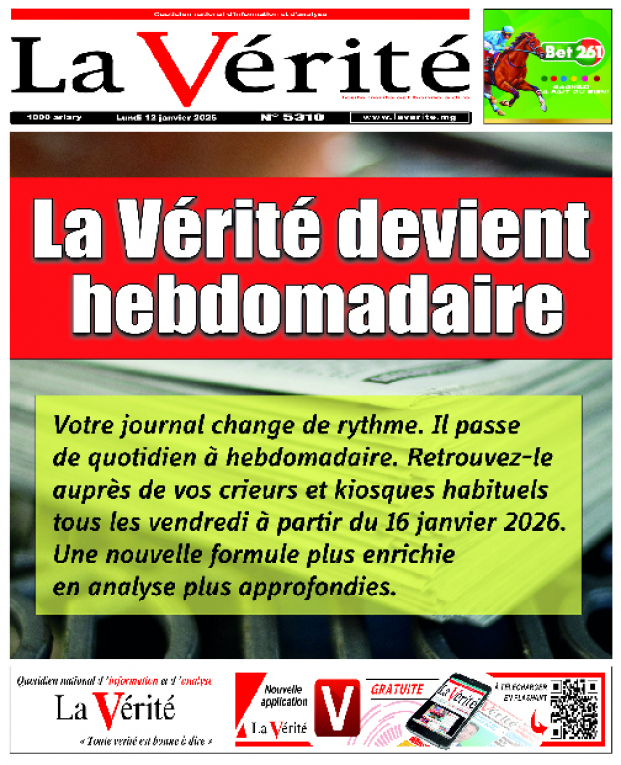Cœur et carrière - Ces couples unis par la passion et la vocation
Publié le jeudi, 12 février 2026Même uniforme, même vision. Ces couples de communicants, politiciens, officiers des Forces de l'ordre, entrepreneurs, sportifs et journalistes prouvent que l’amour peut devenir une force motrice dans la vie professionnelle. Entre défis et réussites, ils incarnent le triomphe d’une alliance où cœur et carrière avancent main dans la main.
Mendrika et Hajatiana Léonard
« Notre passion pour le journalisme a intensifié notre amour »
« On s’est rencontrés sur le terrain en 2015, lors d’une conférence de presse à la météo. J’étais en colère à cause du retard de l’évènement et elle l’a tout de suite remarqué », se souvient Hajatiana Léonard Razafindrasetra, journaliste au sein de l’Express de Madagascar. Quelques jours plus tard, il recroise Mendrika Ramarolahy, journaliste de la télévision Record, au camp Ratsimandrava. Cette fois, il trouve un prétexte simple qu’est de demander l’heure. De discussion en discussion, ils deviennent amis, puis amoureux.
Tous deux journalistes, ils partagent la même vocation, laquelle a intensifié leur amour. « On se comprend sans trop expliquer », confie Hajatiana. Quand l’un ne peut pas assurer un reportage, l’autre prend le relais. Ils se bookent des interviews, élargissent leur réseau et se soutiennent dans les moments de pression. Mais travailler dans le même milieu a aussi ses méfaits. Les problèmes professionnels se mélangent parfois aux sentiments. Les « on dit », les conflits, les noms cités ici et là… Il faut apprendre à faire la part des choses. Et surtout, trouver du temps pour la famille et les enfants.
« A la maison, on essaie de laisser le boulot de côté », disent-ils. Pour eux, se parler, se soutenir et se rappeler que, avant d’être collègues, ils sont un couple uni par l’amour et la même passion, font que la relation marche.
Soafara Ralaimidona et Fanomezantsoa Pharlin Dimbiniaina
Une vie guidée par le taekwondo
A Manjakandriana, leur histoire prenait racine dès l’enfance. Soafara Ralaimidona et Fanomezantsoa Pharlin Dimbiniaina ont grandi ensemble, fréquenté le même établissement scolaire et partagé très tôt le goût du sport. Pourtant, leur relation amoureuse ne débutait que plus tard, au sein du club de Taekwondo de Manjakandriana, où ils pratiquent la même discipline.
A l’origine, Soafara était la première à s’initier au taekwondo, tandis que Fanomezantsoa évoluait dans le karaté. Ce n’est que par la suite qu’il rejoint la discipline, un choix déterminant puisqu’il marque le début de leur histoire commune. L’art martial devient alors le socle de leur relation.
Le taekwondo ne les a jamais quittés. Soafara y consacre même son mémoire de fin d’études à l’Ecole nationale des sports. De son côté, Fanomezantsoa intègre l’équipe nationale pendant trois ans, en devient capitaine, puis entraîneur. Aujourd’hui, il occupe le poste de directeur technique national.
Parents de trois enfants, élevés dans l’amour du sport, ils transmettent naturellement cette passion à leur famille, tout en étant conscients des exigences liées à leurs responsabilités sportives et professionnelles. Soafara est également journaliste et enseignante. Tous deux reconnaissent que le temps et l’engagement peuvent parfois générer des tensions. Mais la discipline apprise sur le tatami nourrit leur compréhension mutuelle. Pour eux, le taekwondo est bien plus qu’un sport : il représente le ciment de leur union.
Capitaine Mendrika - Michaël
« Sous l’uniforme, un amour forgé dans le devoir »
Issus de la 36ème promotion de l'Académie militaire d'Antsirabe. Le chef d'escadron Rakotonirina Hery Mandimby Michaël, commandant au sein de la Compagnie de sécurité intérieure Ivato et le chef d'escadron Arivelo Arovan'i Mesia Mendrika, en service aux Forces d'intervention de la Gendarmerie nationale (FIGN), se sont rencontrés en 2012. « Michaël est admis par le concours organisé par le SEMIPI (« Sekoly MIaramilam-PIrenena), tandis que j'ai franchi la sélection par voie de concours direct. Le destin nous a placés dans la même salle de classe, côte à côte, partageant le même banc. Nous ne savions pas encore que nous allions parcourir tout ce chemin ensemble », confie la femme.
Partager le même métier et la même passion leur permet d’avancer avec une compréhension mutuelle de leurs défis quotidiens. « Nous poursuivons le même objectif : protéger et servir avec discipline et engagement », expliquent ces deux gendarmes. Cette unité de combat et de vision renforce leur complicité et leur donne la force d’affronter ensemble les épreuves.
Mais exercer le même métier implique des sacrifices importants dans la vie familiale. « Il nous est arrivé de devoir mettre de côté nos enfants, notamment pour leur suivi éducatif », reconnaissent-ils. Cette exigence au sein du métier crée parfois un déséquilibre entre leurs responsabilités professionnelles et leur rôle de parents.
Pour faire durer l’amour, ils misent sur la tolérance. « Les désaccords sont inévitables, mais ils nous apprennent à mieux nous comprendre », soulignent-ils. En choisissant chaque jour de pardonner, de patienter et de marcher ensemble malgré les tempêtes, leur amour se fortifie et devient indestructible.
Salaire minimum à 300.000 ariary - Une victoire qui oublie 95 % des travailleurs
Publié le jeudi, 12 février 2026Le salaire minimum d’embauche sera relevé à 300.000 ariary à partir du 1er mars 2026. Présentée comme une avancée sociale majeure, cette revalorisation ne concernera pourtant qu'une infime fraction des travailleurs malgaches. A Madagascar, où l'économie informelle emploie jusqu'à 95 % des actifs, un record mondial, la grande majorité de la population active reste privée de protection salariale et de droits sociaux.
Une revalorisation salariale au bénéfice d'une minorité. L'accord signé le 9 février 2026 au Conseil national du travail porte le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) de 262.680 à 300.000 ariary par mois. Cette hausse de 14 % entend répondre à l'inflation qui érode le pouvoir d'achat des ménages depuis plusieurs années. Arrachée par les syndicats, elle constitue un signal politique fort. Pourtant, ce cap symbolique se heurte à une réalité vertigineuse : Madagascar affiche l'un des taux d'informalité les plus élevés au monde.
Le secteur formel, seul cadre où le SMIG est juridiquement opposable, ne couvre qu'une minorité d'actifs. Le pays compte environ 16,5 millions de personnes en âge de travailler. Moins de 10 % d'entre elles disposent d'un contrat de travail, de cotisations sociales et d'une protection juridique effective. Plus de 15 millions de personnes, soit neuf travailleurs sur dix, évoluent hors du champ d'application de la loi.
Selon le Fonds monétaire international, la part de l'emploi généré par l'économie informelle atteint 95 % à Madagascar, l'un des taux les plus élevés jamais enregistrés dans le monde. L'Institut national de la statistique confirme cette prédominance : plus de 90 % des unités de production informelles fonctionnent sans aucun enregistrement officiel. Agriculteurs, petits commerçants, employés de maison, artisans, travailleurs à la tâche : tous évoluent dans un océan de précarité où le SMIG reste un horizon hors d'atteinte.
L’informel, un monde hétérogène mais massivement précaire
Le salaire dans le secteur informel varie de 50.000 ariary (certains employés de maison) à l'infini, selon le type d'activité et le statut de la personne. Certains acteurs mieux placés, grossistes, propriétaires de magasins bien situés, petits importateurs, gagnent bien plus que des salariés du secteur formel. L'informel n'est donc pas un bloc homogène : y cohabitent une précarité extrême et une réelle aisance économique.
Mais pour la grande majorité des travailleurs non spécialisés, le revenu mensuel dépasse à peine 200.000 ariary, quand il atteint ce seuil. Ces hommes et ces femmes exercent des métiers sans contrat, sans protection sociale, sans perspective d'évolution. Sans qualification, il est très difficile de sortir de cette basse tranche de revenus. L'informel agit alors comme un amortisseur social, mais aussi comme un piège à pauvreté.
La Banque mondiale précise que près de 80 % des gens âgés de 15 à 24 ans travaillent dans l'informel, sans couverture sociale ni possibilité réelle de mobilité professionnelle. Pour eux, la revalorisation du SMIG est une promesse qui ne franchira jamais les portes de l'atelier ni l'étal du marché. Victoire syndicale, oui. Mais victoire en trompe l'œil, tant que neuf actifs sur dix demeurent invisibles aux yeux du droit.
PME et informalité : quand le coût de la loi et l'arbitraire fiscal dissuadent la formalisation
Les petites et moyennes entreprises, pourtant viviers potentiels d'emplois décents, peinent à sortir de l'ombre. Accès limité au financement, marges faibles, charges administratives et fiscales jugées trop lourdes : autant de freins qui les maintiennent dans l'informel ou retardent leur régularisation. Une étude du Programme des Nations unies pour le développement estime que seules 7 % des entreprises malgaches sont formellement enregistrées.
Mais au-delà des contraintes structurelles, c'est parfois le choc direct avec l'Administration qui achève de décourager les plus courageux. Rakotonirina Joseph, menuisier à Ambohimanarina, en a fait l'amère expérience. En 2018, après quinze ans dans l'informel, il décide de se mettre en règle. Il immatricule son atelier, déclare ses deux apprentis, commence à payer ses impôts et cotise à la CNAPS. « Je voulais être honnête, travailler proprement, avoir une retraite un jour », confie-t-il.
Cinq ans plus tard, il reçoit une lettre de service des impôts lui notifiant un redressement fiscal. « Les agents m'ont dit que j'avais commis des erreurs, que je devais payer une pénalité. Mais ils n'ont pas pu me montrer quel article du code j'avais violé ». Le montant réclamé : 40 millions d'ariary, alors qu'il peine à réaliser 12 millions d’ariary de chiffre d'affaires par an. Une somme qu'il ne peut pas payer. « Ils m'ont dit : “On peut négocier.” J'ai compris. J'ai dû discuter comme au marché. Ce que j'ai payé ne correspond pas au reçu qui m'a été délivré ».
Démoralisé, Rakotonirina a fini par tout abandonner. « J'ai arrêté de déclarer, j'ai fait une cessation d'activité. Je ne paie plus rien. Mes apprentis, je les paie à la tâche, sans contrat. Je suis retourné dans l'informel. Au moins, là-bas, personne ne vient vous embêter sans raison ».
Son histoire, des centaines de petits entrepreneurs la racontent à mots couverts, par peur de représailles. Elle illustre ce que les rapports officiels appellent pudiquement des « pratiques discrétionnaires » et que les opérateurs économiques, eux, nomment plus crûment : une Administration qui fait la loi sans base légale, où tout se négocie, où la frontière entre contrôle et tentative de corruption s'efface.
Les représentants des PME évoquent aussi le poids des cotisations sociales, la complexité des procédures, mais surtout l'insécurité juridique et l'arbitraire des contrôles comme principaux obstacles à la formalisation. Résultat : des millions de travailleurs restent invisibles aux yeux de la loi, et la hausse du salaire minimum n'y change rien.
Une revalorisation nécessaire, mais impuissante sans Etat de droit. Relever le SMIG à 300.000 ariary est une victoire sociale indéniable, un signal fort adressé aux travailleurs du secteur formel et aux partenaires sociaux. Mais cette mesure ne peut, à elle seule, réduire les inégalités structurelles du marché du travail malgache.
Tant que neuf actifs sur dix exerceront en marge du cadre légal, toute politique salariale restera lettre morte pour la majorité silencieuse. Le véritable défi n'est pas seulement d'augmenter les salaires, mais de construire les conditions d'une formalisation massive : soutien effectif aux PME, simplification administrative, incitations fiscales, accès élargi à la protection sociale.
Et surtout, instaurer une relation de confiance entre l'Administration et les contribuables, où la loi s'impose à tous, y compris à ceux censés la faire appliquer. Tant que l'arbitraire fiscal et les pratiques discrétionnaires continueront de punir ceux qui choisissent la légalité, la formalisation restera un risque, mais non pas une opportunité.
Sans cela, la loi continuera de courir derrière une réalité qui lui échappe. Et des millions de Malgaches, comme Rakotonirina Joseph, continueront de préférer l'ombre protectrice de l'informel à la lumière aveuglante d'un Etat qui protège mal et sanctionne trop.
Sources :
Communiqué conjoint du ministère du Travail et des partenaires sociaux, Antananarivo, février 2026.
Banque mondiale, « Madagascar Economic Update : Navigating Fragility », décembre 2025.
INSTAT, Enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel (ENEMPSI), rapport 2024.
Fonds monétaire international, Article IV Consultation - Madagascar, rapport pays n° 25/38, janvier 2025.
BIT, « Women and men in the informal economy : A statistical picture », 4ème édition, 2024.
INSTAT/PNUD, Profil du secteur informel à Madagascar, 2024.
Banque mondiale, Jeunes et emploi à Madagascar : défis et opportunités, 2025.
PNUD, Evaluation du climat des affaires et de la formalisation des entreprises à Madagascar, 2024.
Conseil du patronat malgache (CPM), Livre blanc sur la formalisation des PME, 2025.
L.R
Mariage, tentations et foi - La FJKM au chevet des couples
Publié le mardi, 10 février 2026Violences conjugales, adultère, influence de l’Internet, etc. Bon nombre de couples, y compris ceux chrétiens, font face à ces défis au quotidien. Raison pour laquelle l’Eglise FJKM, à travers son programme « Vontom-pitia », mise entre autres sur les partages des vécus quotidiens et les counselings. Des conférences thématiques seront au programme, durant la semaine du 9 février 2026.
Importation de véhicules - Le boom coréen transforme le marché de l’occasion malagasy
Publié le mardi, 10 février 2026Chapeau : Le parc automobile malagasy se transforme rapidement, porté par une demande croissante en mobilité et l’ouverture du marché aux importations. Les voitures d’occasion coréennes dominent ce mouvement, tandis que les véhicules neufs et les premières initiatives électriques commencent à redessiner le paysage du secteur.
Banditisme et meurtres atroces - Les vécus traumatisants de deux femmes
Publié le mardi, 10 février 2026Deux jeunes issus de familles différentes ont été assassinés de façon barbare. Etranges coïncidences ou non, mais les faits sont survenus aux jours de leurs anniversaires.
Dans l'ombre de la ville, deux destins ont été brisés par une violence sans nom. A Tsimbazaza, le petit Miguel, à peine âgé de 6 ans, est retrouvé mort au lendemain de son anniversaire. Quelques mois avant cela, la jeune Tricha, qui allaient fêter ses 18 printemps et passer son baccalauréat, succombe à la sauvagerie des bandits, selon des sources. Leurs mères livrent aujourd'hui, avec une douleur à peine contenue, le récit de leur calvaire et de leur combat pour tenter de vivre encore. Les faits.
Professeur Henri Rasamoelina - « L’ombre de la France plane toujours ! »
Publié le mardi, 10 février 2026Ministre Hanitra Razafimanantsoa - « 2026 l'année de la Concertation, 2027 l'année des élections »
Publié le lundi, 26 janvier 2026Ministre d’État auprès de la Présidence chargée de la Refondation, Maître Hanitra Razafimanantsoa revient avec nous sur le processus de concertation nationale inclusive prévu pour 2026. Elle y précise le calendrier menant aux élections de 2027, les thématiques prioritaires comme la décentralisation et le rôle de médiateur confié au FFKM. Entretien.
Harcèlement scolaire - Haingo Rakotomanga a souffert en silence
Publié le jeudi, 22 janvier 2026Elle avait 12 ans. Elle était en classe de 5ème à l’école des sœurs sise à Andohalo. Elle avait une meilleure amie, une présence rassurante à ses côtés pendant des mois avant que tout change. Elle, c’est Haingo Rakotomanga, une survivante de harcèlements scolaires mais qui a pu s’en rétablir pour devenir une femme entrepreneure.
« Ma meilleure amie et moi ne se quittions jamais, mais elle s’est éloignée, m’a ignorée et s’est même moquée de moi, des changements brusques que je n’arrivais pas à accepter. Je lui ai finalement demandé la raison et sa réponse a été un coup dur "parce que tu es trop sage !" », se souvient-elle. Depuis, elle a subi de nombreux cas de harcèlement scolaire, dont les surnoms, les rires moqueurs, les regards insistants. Son ancienne meilleure amie a même fait partie des premières à se moquer d’elle, surtout à cause de sa physique qu’elle avait elle-même du mal à reconnaître. « J’avais l’impression qu’on se moquait de moi tout le temps. Je me suis renfermée et a gardé le silence, non seulement à cause de la honte mais surtout par peur qu’en parler va empirer la situation », raconte-t-elle.
La Vérité devient hebdomadaire
Publié le lundi, 12 janvier 2026LA VERITE
Publié le lundi, 12 janvier 2026
Fil infos
- Cœur et carrière - Ces couples unis par la passion et la vocation
- Salaire minimum à 300.000 ariary - Une victoire qui oublie 95 % des travailleurs
- Professeur Henri Rasamoelina - « L’ombre de la France plane toujours ! »
- Ministre Hanitra Razafimanantsoa - « 2026 l'année de la Concertation, 2027 l'année des élections »
- La Vérité devient hebdomadaire
- Refondation - Le chef de l’État reconnaît une guerre intestine
- Grève surprise à l’Hôtel Carlton - Les salariés dénoncent une « mise au chômage technique » sans préavis
- Université d’Antananarivo - Le Dr Alain Mérieux honoré du titre de Docteur Honoris Causa
- Mpox - Madagascar sous surveillance sanitaire de ses îles voisines
- Polyclinique Ilafy - Des mesures temporaires évoquées par le gouvernement pour les patients dialysés
Editorial
-
Opération délicate
Le faux et l’usage de faux envahissent l’Administration, grand « A » s’il vous plaît, à savoir le domaine général qui englobe tous les secteurs d’activités de l’Etat ou de la République. Faux et usages de faux, du jargon populaire « fosika », faux diplômes ou certificats de fin d’étude gangrènent presque tous les Corps de métier de l’Administration entre autres les départements clés comme l’Enseignement supérieur, l’Education nationale, la Justice, la Régie financière, les Forces de défense et de la sécurité (FDS), etc. Les concours d’entrée dans l’administration publique sont infestés de faux dossiers. Des diplômes de Baccalauréat, de Licence, de Master I ou II se trouvent les plus menacés. Il y a eu même certains de faux diplômes de Doctorat !